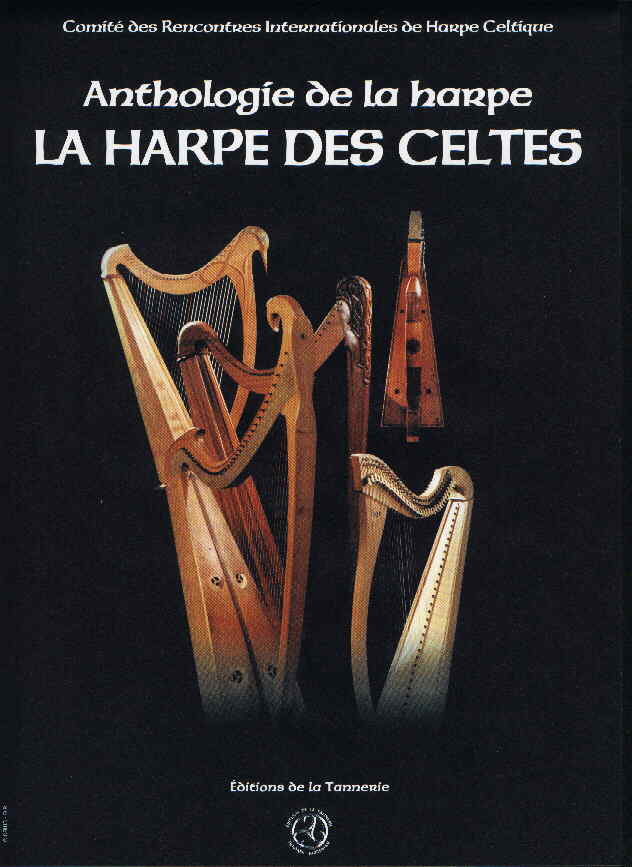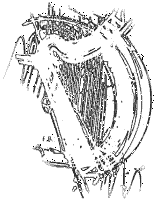HARPE CELTIQUE
- Depuis
sa renaissance en Bretagne, au milieu du XXe
siècle, la harpe celtique bénéficie
d'un développement inespéré et
difficilement imaginable il y a seulement cinquante ans.
A une époque où les genres musicaux se font
connaître partout dans le monde et, parfois,
s'interpénètrent, que les échanges
entre cultures n'ont jamais été aussi
forts, elle semble trouver une place originale au sein de
la musique contemporaine. De ces échanges sont
nées des trajectoires musicales bien
différentes de son principal
répertoire.
-
- Que
devrons-nous retenir de cette période de
création? Le terme même de " celtique "; ne
lui fermerait-il pas d'autres horizons possibles? Aurait-
elle atteint une maturité précoce, trop
rapide, dans un siècle où les
possibilités d'écriture sont multiples et
où la moindre sonorité nouvelle est
aussitôt intégrée au discours
musical? Faut-il croire que la place de la harpe celtique
se doit de demeurer avant tout au sein du domaine
traditionnel breton et qu'il est audacieux de vouloir en
aborder d'autres avec un instrument qui a, finalement,
beaucoup de mal à sortir de son histoire et de
l'image qu'il conserve dans les
mentalités?
-
- L'instrument mythique, celui des bardes,
le symbole de la Celtie, ainsi que tout un esprit
traditionnel qui a été porté aux
nues à l'époque romantique lui
confèrent une image bien distincte de la harpe
classique. Au début de la seconde moitié du
XX° siècle, jouer de la harpe celtique
signifiait délibérément prendre
position en faveur de la musique du même nom et
participer à une renaissance culturelle au
demeurant exceptionnelle. Cette situation semble
aujourd'hui évoluer.
-
- La
petite harpe possède une richesse dont nous
n'avons encore réalisé ni la nature ni
l'étendue. Contrairement à d'autres
instruments acteurs de la musique traditionnelle en
Bretagne (de façon relativement récente
pour certains), il n'y a pas de " classe musicale " au
sens d'école propre à cet instrument.
Tandis que la harpe irlandaise fonde son style sur un
modèle musical en rapport étroit avec le
legs du compositeur et harpiste O'Carolan, (lui
même tributaire de la tradition baroque de la fin
du XVIIe siècle), la harpe en Bretagne ne semble
pas s'être laissé accaparer par un courant
musical unique. Bien au contraire, tous les styles,
toutes les influences possibles et imaginables se
retrouvent. Pour s'en convaincre, il n'est que
d'écouter deux harpistes bretons pour comprendre
combien grandes peuvent être les différences
et comment chacun défriche le champ musical propre
à sa personnalité. Désormais
présente dans le monde entier, la harpe sort
inexorablement de son répertoire traditionnel. La
littérature musicale qui lui est
dédiée montre à quel point,
aujourd'hui, elle se porte bien. Ses
particularités techniques et sonores, à
l'origine de son développement, lui assurent un
répertoire original.
- Il est
intéressant de se pencher sur les raisons pour
lesquelles des compositeurs, de milieux très
différents, s'intéressent à la
petite harpe. Peu d'entre eux évoquent le
côté symbolique qu'elle représente
pour la tradition celte. Ils retiennent davantage une
sonorité particulière, une "saveur acide"
des cordes en nylon ou bien les vibrations
singulières des cordes en métal
utilisées par Jean-Louis Dhaine dans sa Suite
Kimrtste (Grand prix de composition, 1984, Dinan).
Possibilités sonores d'autant plus nombreuses
qu'il existe une grande diversité de
matériaux utilisés pour la fabrication des
cordes (boyau, métal, nylon, ou autres
matériaux composites).
-
- De plus
en plus de compositeurs à la recherche de
sonorités des plus originales découvrent un
instrument qui leur permet d'exprimer pleinement leur
imaginaire créatif. Le choix de la harpe celtique
s'accompagne, chez certains, d'une véritable
démarche de recherche musicale et de tout un
système compositionnel construit autour de
l'instrument. La harpe en général, mais
surtout la harpe celtique en particulier, reste un
instrument de l'imaginaire.
-
- Le
développement du répertoire passe, en
premier lieu, par une meilleure maîtrise des
possibilités de l'instrument. Certaines personnes,
dès l'origine de sa renaissance, ont
favorisé ce développement. La
présence dans le domaine musical contemporain de
la harpiste Denise Megevand, et l'intérêt
manifeste qu'elle y a porté ont favorisé
l'arrivée de
- nombreux
compositeurs. Ces incitations, comme en témoignent
toutes les oeuvres qui lui sont dédiées,
ont abouti à l'enrichissement du
répertoire. Les Rencontres internationales de
Dinan, avec le concours de composition, ont
également joué ce rôle de
catalyseur.
-
- Cette
entrée en matière, qui ne se prétend
pas exhaustive loin de là, et qui a pour seule
ambition de lancer le débat, ne doit surtout pas
oublier les luthiers auxquels on doit cette alchimie
première entre le sonore et le matériel.
Nous aurions pu d'ailleurs commencer par eux car ils sont
à la source de la production musicale. Leurs
réalisations sont souvent des oeuvres d'art, les
formes et les lignes ajoutant à la qualité
musicale. Chaque instrument est une pièce unique
qui réunit autour d'elle les acteurs d'une
même passion ne demandant qu'à être
partagée.
-
- Myrdhin
|